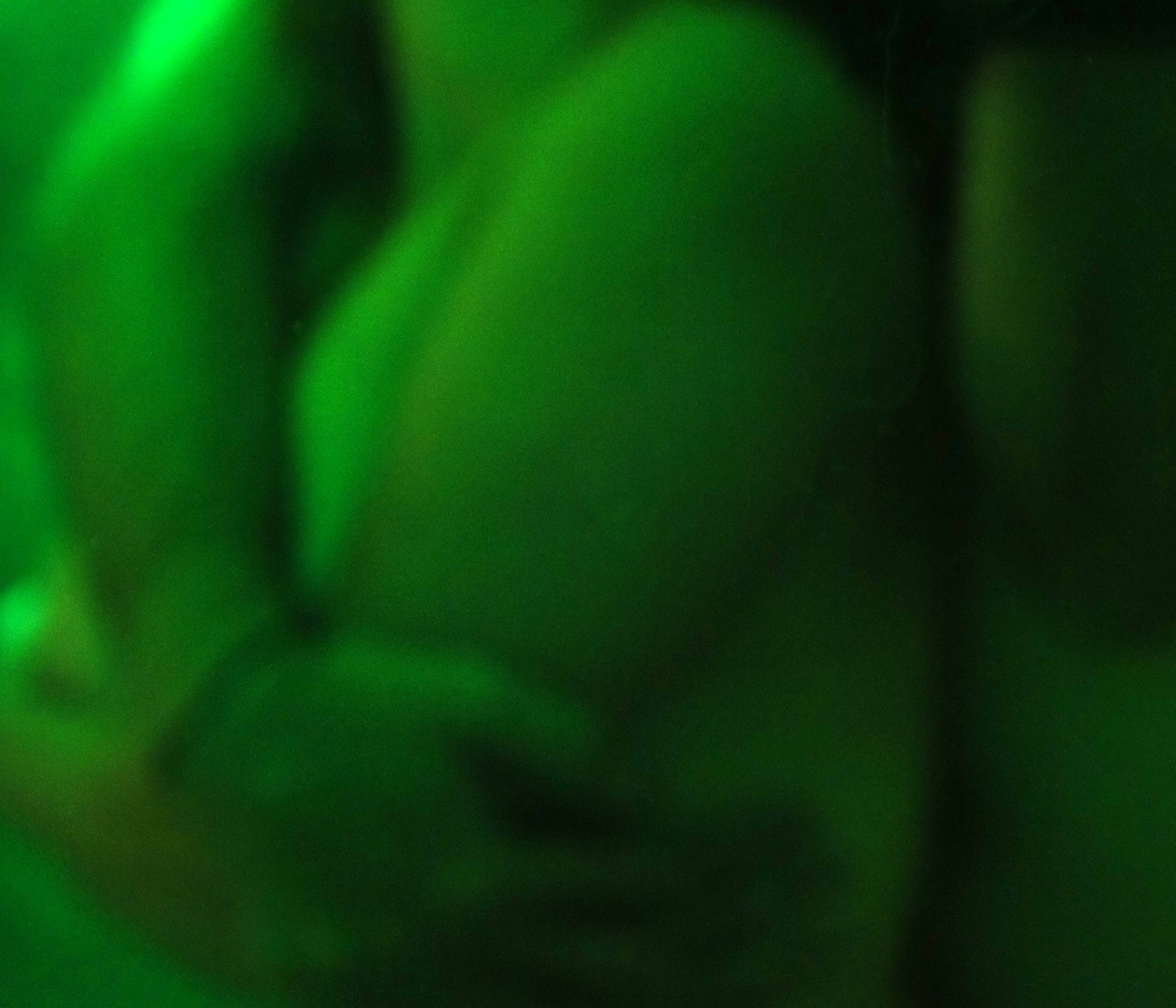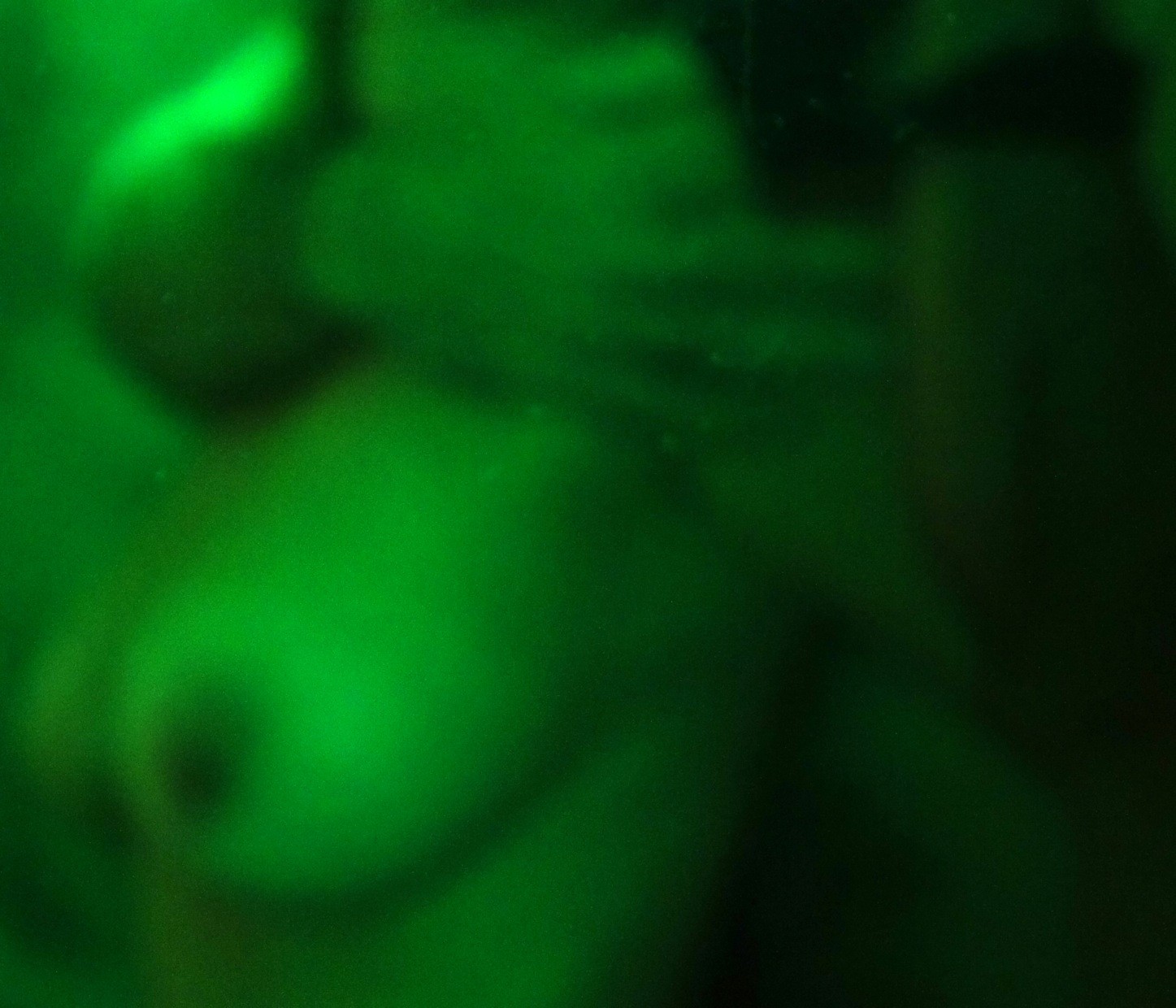Polar (2024-2025)
Film sur les Tanneries Haas / épisode 1 (2024-2025)
avec Bénédicte Bach
Hybridations (2022-24)
Hybridations est un travail de plus de 2 ans. Il s’agit, après avoir présenté une forme de synthèse de 25 ans de travaux en 2022, de poursuivre cette réflexion sur le médium photographique, d’en tester de nouvelles évolutions et de s’interroger sur le sens des images.
Cette série, volontairement foisonnante, s’autorise à reprendre des éléments clés de mes anciennes séries (sans refaire les mêmes images) et à les mélanger ; là où auparavant j’aurai décliné une thématique sur un certain nombre d’images, en allant au bout de la démarche, ici, je mixe différentes pistes qui ensemble racontent un grand voyage. On y trouve des portraits, des détournements d’affiches publicitaires, des iconographies religieuses, de l’architecture nocturne, des écritures, des mises en scène théâtrales, un peu de street photographie. Une recette très épicée donc, haute en couleur. Un corpus riche.
Après avoir questionné depuis toujours la matérialité d’une image, et à quels codes elle se réfère, il s’agit de poursuivre ici la réflexion de l’impact de l’IA sur la construction de nos images. L’IA est partout aujourd’hui, dans nos boîtiers d’appareils photographiques, nos smartphones, et bien sûr en tant que tel sur ordinateur avec des logiciels spécifiques : Photoshop, Lightroom ou Google utilisent également l’intelligence artificielle pour améliorer nos images. Que faire alors de ces images ? Comment les lire et que nous racontent-elles de notre époque ?
Cette question a toujours été centrale dans mon travail. Venant de l’argentique, avec des pellicules et des contraintes spécifiques, j’ai toujours cherché à tester les limites du médium, à faire parfois ce qu’il ne fallait pas faire, des flous, des bougés, des jeux de temps de pause, des superpositions... pour expérimenter, et m’approprier la réalité que j’avais sous les yeux pour en faire quelque chose d’autre, construire, raconter des histoires qui me sont propres, personnelles, et, qui n’existent d’abord que parce que je les ai voulues, imaginées.
Au gré des évolutions techniques, j’ai gardé cette façon de penser l’image dans mon travail. L’essentiel étant le sens que l’on donne aux choses, à sa démarche, aux intentions : le résultat final d’une image n’est qu’une partie de tout un processus, parfois long et complexe. Le smartphone est aujourd’hui devenu mon compagnon photographique du quotidien, toujours en poche, et donc disponible, d’une qualité quasiment équivalente à mon appareil photo. Il me permet d’être toujours à l’affût et d’être en capacité de prendre une image comme une prise de note : indispensable.
La science progresse, faisant de nous des usagers computationnels capables de produire des contenus séduisants. L’IA, révolution en cours, qui bouleverse notre rapport au réel, à la fabrication d’images et de vidéos, permet de créer des mondes sans acteurs, de faire des portraits sans modèle, des paysages sans avoir bougé de chez soi, des musiques sans instrument.
Mais la technique n’est pas une fin en soi : un travail artistique est toujours personnel, on y glisse ses obsessions, ses récurrences, ses questionnements, sa personnalité. Il y a dans ce travail, au-delà de l’approche culturelle et sociétale, un goût pour les autres, une quête joyeuse, de relations, d’échanges, de réflexion sur le monde et de ses symboles de consommation, la lumière. L’idée d’une utopie.
Alors, que reste t-il aux créateurs, aux artistes ? Je n’éprouve pas d’aversion «morale» pour ces évolutions, et laisse ces débats aux philosophes et aux penseurs qui vont s’emparer de cette question et contribuer à construire une éthique sur le sujet. Ce qui m’intéresse, c’est de pouvoir utiliser un outil supplémentaire, qui m’offre de nouvelles opportunités. Il restera toujours la poésie, la pensée, le travail et l’émotion.
Mes images IA sont le résultat de variations infimes du même prompt et d’un long travail de recherche. Nous ne maîtrisons pas les algorithmes et la «nourriture» permettant de générer ces résultats et cela pose évidemment question. L’usage de l’IA m’était nécessaire, au-delà de l’aspect expérimental qui m’intriguait, parce qu’il me permettait de ne pas mobiliser des ressources de personnages, de décors, de costumes, que je n’aurais de toute façon pas réussi à rassembler. J’avais des envies d’images très précises en tête.
Hybridations est une sorte de grande fête, juste avant le chaos, comme une métaphore du monde dans lequel on vit, et recèle un avant goût de dérapage, de quelque chose qui va se transformer, éclater, exploser. Mais au-delà cette menace, il y a aussi de l’humour, des juxtapositions d’images qui dans leur rythme, leur enchaînement construisent un corpus où l’on ne sait plus réellement ce qui est vrai, ce qui est faux. Et cela fait, bien sûr, l’objet d’un jeu pour le spectateur, au delà des images crépusculaires, de trouver quelles images ont été crées avec l’aide de l’IA. Il y a donc également de vraies personnes, qui ont pris la pose, des néons, des villes, des ambiances nocturnes, des scènes de vie, des mouvements de caméra subjectifs, des icônes, et des écritures au statut particulier, des photographies bien réelles, avec des sourires et une pointe d’ironie : un questionnement sur nos imaginaires contemporains, aux multiples entrées et références. Des formes qui s’agglomèrent dans une vision kaléidoscopique. Une écriture cinématographique. Que donne t-on à voir ? Comment construit-on une narration ? Quel est le sens des discours que nous produisons ? Entre humour, mythologies et apocalypse, Hybridations, sous ses airs acidulés et survitaminés, en dit beaucoup de notre époque.
Benjamin Kiffel
Variations chromatiques (2022)
Le film photographique Variations chromatiques est une fenêtre ouverte sur une nouvelle voie d’expérimentation, et poursuit une réflexion engagée sur la dématérialisation et le statut d'une image photographique. Ce film est un objet particulier, pensé à l'ère du digital. Construit à partir de 13 séquences de 5 secondes d’une même image, seule la chromie évolue, en passant du jaune au rouge, du bleu au vert. Chaque séquence constitue l’objet d’un NFT unique mis en vente durant l’exposition sur la plateforme Objkt.com sur le profil Benkiffel.
Pour l’acquisition de chaque NFT, un tirage correspondant est associé.
Les L du désir (2019-2021)

Les ailes du désir de Wim Wenders est un film mythique. Il évoque une période, une figure légendaire, rassurante, douce,
sereine et protectrice.
L'entreprise L&L products, groupe américain, travaille sur des structures qui renforcent, qui insonorisent, qui fixent différents composants créés sur mesure, et alimentent
les secteurs automobile et de l'aérospatiale notamment. Elle est présente au niveau mondial et propose des produits avec des technologies de pointe.
L'idée d'associer ces deux univers différents se fait d'abord par la sémantique, un jeu de mot, 2 L deviennent des ailes. La
poétique du sens, l'imaginaire.
Au delà de la métaphore phonétique, utiliser, détourner un personnage emblématique, issu d'une culture populaire, est intéressante. Elle apparaît comme une idée d'un monde
disparu : le mur de Berlin n'existe plus, mais son ancrage imaginaire dépasse l'époque de sa réalisation. Son caractère universel résonne comme un élément culturel partagé, un
ange qui n'est pas religieux, un personnage qui veille sur les « vivants » est anachronique à notre époque. Il emprunte à notre civilisation sa capacité à produire et à jouer
avec les mythes. Personnage baroque, régulièrement utilisé dans une culture aux frontières du kitch, cet ange cinématographique a une entité pop. Il s'agit donc d'un clin
d'oeil, d'un hommage, d'une référence culturelle, d'une œuvre poétique questionnant de nombreux ressorts.
Benjamin Kiffel, artiste travaillant sur l'image et les représentations, qui aime détourner des symboles, se propose d'associer le savoir faire industriel de son mécène et sa vision poétique. Après avoir « explosé » les repères de la place Broglie en 2018 avec le groupe Béton Fehr, il interroge les registres d'une mémoire culturelle, détourne une iconographie fictive et légendaire.
Produire une sculpture monumentale dans une industrie est un geste fort. Fédérateur. Il associe les compétences techniques des différents départements de l'entreprise, au service d'une œuvre artistique. L'artiste transforme l'usage habituel de l'activité de son mécène et produit , de concert avec les salariés du groupe, une œuvre commune.
Un geste qui raconte une histoire, un symbole, un emblème.
Eriger un monument poétique et empli de significations - la sérénité, la bienveillance, le souci des autres - répond aux valeurs de l'entreprise. Porter ce message sur la place publique avant de le réintégrer au cœur même de l'usine valorise la coopération au sein des équipes, renforce le sentiment d'appartenance au groupe. Une sculpture qui magnifie les savoir-faire du mécène et met en lumière sa capacité créatrice. L'artiste tisse des liens au travers d'un projet commun.
La réalisation monumentale, au delà de son ADN technique, a également une portée poétique. Jouer des codes culturels et interroger le sens d'une sculpture dans l'espace public. Ce n'est pas une figure militaire ou un personnage historique , c'est un héros fictif, il transgresse les normes.
C'est un hommage au cinéma, à une vision poétique du monde. Le personnage est suffisamment mythique pour être reconnu, il est également suffisamment universel pour toucher les personnes ne connaissant pas la référence. Un ange bienveillant portant son regard sur les passants et les personnes en terrasse est un geste doux, rassurant, voire drôle. Il veille devant le café Berlin sur la place d'Austerlitz.
L'ange est aussi un symbole de pureté, de liberté, c'est en lui même une icône. La création se propose donc de jouer des codes culturels occidentaux, d'en détourner les symboles, d'ouvrir un espace imaginaire.
Les L&L du désir, c'est une évocation, une métaphore, un geste poétique.
Mettre en lumière une technicité, souvent invisible, mais essentielle, qui veille à la sécurité des usagers, à leur confort et surtout émouvoir.
L'oeuvre co-produite avec les équipes de L&L Products a été présentée du 3 au 13 juin 2021 pour L'Industrie Magnifique.
Benjamin Kiffel
Un film qui raconte la formidable aventure collaborative de l'Ange avec mon mécène L&L Products. Les coulisses de la création, des Hommes, des sourires, de l'émotion.
Les cowboys et les Indiens (2020-2021)
Cette série a été réalisée lors du second confinement de novembre 2020.
Conçu comme un journal, ces photographies mettant en scène les personnes de mon entourage proche servent de support à une narration décalée et sont accompagnées de petits textes illustrant l'état d'esprit du moment qui se jouent de l'actualité médiatique omniprésente. Des portraits en noir et blanc, actor studio, une lumière dure ou veloutée, du jeu. En tête également nombre de références, photographiques ou non, alimentant l'interaction avec le spectateur. Dans un monde où règne l'absurde, un vrai western. La narration au jour le jour le jour est visible sur facebook.


Et vînt la lumière...(2020-2021)
Et vînt la lumière...
A la sortie du premier confinement de Mars 2020, après la sidération de ce moment si particulier, s'est fait sentir un fort besoin de lumière, de nature, d'oxygénation.
Ce travail est d'abord une quête. Une envie de liberté. Une bouffée d'air pur.
L'intérêt pour la lumière est présent dans mon travail depuis toujours, dès la fin des années 90, elle est essentiellement nocturne et artificielle, et structure des espaces photographiés, urbains pour la plupart. Lors de mon appropriation d'un paysage diurne en Lorraine en 2007, dans ''Extraits du Saulnois'', apparaît également la volonté d'inscrire dans le paysage une intervention ''physique'' dans l'espace, avec une croix de néon géante, comme un signe d'interférence entre le réel et le fantasmé. Un usage poétique, une écriture. Ces dernières années, ces passages entre l'image et l'espace ont fait l'objet de nombreux questionnements et de propositions. Dans '' Perspectives poétiques N:21'', les néons posés sur le mur, évoquent le lieu industriel et donnent une autre perspective à ceux présents sur l'image gravée dans le béton. Pour l'ange des ''L du désir'', la lumière est intégrée à la sculpture, l'éclairant de l'intérieur et un cercle bleuté vient rappeler cette irréalité. La lumière, au delà de sa capacité à structurer des espaces dans une image, est devenue une écriture physique, jouant des codes culturels et interrogeant nos imaginaires.
Dans cette quête post-confinement, elle s'assume, centrale, comme une utopie, une possibilité. Quelque chose de mystique. Une croyance.
Le geste est presque religieux, lointain héritier de l'Arte Povera et de Mario Merz, dans le sens où il oppose des matériaux du quotidien à une succession d'images sophistiquées.
Un débat sur le réel d'où semble émerger une réponse spirituelle. Ce qui prime ici, c'est l'incandescence, le souffle de la lumière, son évidence.
Posée ou suspendue de façon minimaliste, elle suggère davantage qu'elle ne démontre, elle interfère avec le classicisme lyrique et structuré des photographies, elle en est une métaphore. C'est dans ce jeu, de détournement, d'apparition et de recomposition, de questionnement, que ce situe cette proposition.
Les images dont les lignes verticales laissent filtrer des rayons naturels campent un univers familier, pas tant pour l'auteur, habituellement aux antipodes de ce type de lieu, mais pour le spectateur. Le noir et blanc suggère une radicalité, et participe à la déconstruction de ce réel, en cherche la transcendance. Clinique.
En contre-point, un dispositif animé, projeté, de plans quasi fixes, nous emmène lentement dans un mouvement, contredit par l'objet inanimé jonché au sol mais irradiant la perspective. Des images fixes qui défilent dans un mode structuré, une vidéo de mouvements quasi figés, une intervention dans l'espace qui interfère avec l'ensemble tout en en faisant partie.
Et vînt la lumière... une incantation, une promesse, une évidence. C'est dans la disparition que réside la mémoire. C'est dans le souffle irradiant de la lumière que naît la poésie.
Benjamin Kiffel
Enter the void (2020)
Cette série est réalisée pendant le confinement lié au covid19 en avril 2020.
Un porte s'ouvre sur une autre réalité. Un monde où les statues de pierre observent, marchent sur les routes désertées. Ces géants qui prennent possession de la ville sont ils le symbole d'une puissance passée ou incarnent ils la reconstruction? De nouveaux passages s'ouvrent. Il y a aura forcément un après. Un monde à plusieurs entrées. Ces personnages dégagent une force, sombre réminiscente. Aux frontières de la science fiction. Un souvenir? Une mémoire? Une métaphore? A l'heure des choix. Plus rien ne sera comme avant. Enter the void.
Métropoles (2018/19)
Le travail de Benjamin Kiffel est résolument centré sur un univers urbain, univers qu’il explore de longue date dans son registre photographique notamment, à travers le prisme de la lumière en révélant ainsi sa poésie pour mieux l’inscrire dans nos mémoires.
Avec Métropoles, Benjamin Kiffel questionne la « ville-mère », l’espace architecturé de la cité dans ce que l’éclairage public en dévoile. Cette réflexion, abordée précédemment sous l’angle industriel (Port du Rhin Strasbourg, Nocturnes, Extérieur nuit) ou plus baroque (Roma, inspiration baroque) est portée ici par un discours formellement expressionniste. Milan, Barcelone et Berlin. Du sud au nord, trois villes, le même regard. Des noirs et blancs structurés et contrastés qui font naturellement écho au cinéma de Fritz Lang et aux photomontages de Paul Citroen.
D’abord les yeux rivés sur la skyline milanaise, on plonge progressivement vers le cœur de la ville à Barcelone pour finir dans un tourbillon lumineux à Berlin. Le noir des gratte-ciels milanais, frontière entre terre et ciel, se concentre et s’ouvre à la nuit pour donner toute sa place à la lumière à Berlin et recomposer l’espace. La ville, d’abord labyrinthe verticalisé, se déploie des profondeurs à la surface pour finir dans une spirale étincelante.
Avec ses divagations spatiales, Benjamin Kiffel nous offre de nouvelles cartes mentales, éminemment subjectives, dans la droite ligne des expressionnistes. Le point de vue est radical, tant dans les cadrages que dans la composition et les superpositions. La réalité est bousculée pour provoquer une réaction émotionnelle du spectateur. Chacune des séries présentées dans cette exposition – « Supernova », «Vertigo» et «Das licht» – est une reconstruction de l’espace en une ville imaginaire dans laquelle la lumière, le plus souvent artificielle, semble en faire battre le cœur.
Dans cette vision d’une intensité forte, Benjamin Kiffel passe ainsi de la dystopie des expressionnistes à une utopie nouvelle. Il se dégage une impression de légèreté et de fragilité dans ses superpositions. La lumière se fait dentelle et vient souligner un paysage urbain quotidien, comme un vêtement de luxe. Les perspectives sont bousculées à dessein par l’artiste qui s’attache aux lignes architecturales des lieux dans une écriture nouvelle.
Le rapport au temps est également déconnecté du réel. Ici, passé, présent et avenir sont intimement mêlés. Les strates s’empilent et s’emboîtent dans un ordonnancement méthodique, une mise en exergue systématique d’un paysage particulier hors du temps ouvrant de nouveaux horizons.
En portant son regard expressionniste sur ces trois métropoles – Milan, Barcelone et Berlin – Benjamin Kiffel marque l’empreinte d’une réalité urbaine et architecturale redessinée à l’aune de l’éclairage public. Une vision utopique et onirique, une écriture déstructurée et multidimensionnelle, un équilibre intemporel et flottant : la mémoire poétisée d’une urbanité particulière.
Supernova (2018) est une série sur l'utopie, la construction d'une ville imaginaire. Les plans se succèdent, se superposent, la lumière et les lignes se croisent, se confondent, dessinent de nouveaux espaces. Les architectures sont détournées, entre structure et chaos. Le vertige graphique de ces compositions annonce une autre réalité, celle d'une luminosité forte d'une étoile en fin de vie. Juste avant. Super et Nova sont également empruntés au vocable d'Alfa Roméo, designer d'art et d'histoire avec leurs automobiles faites à Turin ou à Milan... Rome, Milan, Turin, des quartiers anciens, le Lingotto industriel, et Porta Nova La Milanaise... Une culture de lumière. une tentative utopique. La ville. L'équilibre ou le chaos?
Vertigo a été réalisé à Barcelone en 2018, lieu où l'artiste avait déjà fait sa série "Custo" en 2011. Ici, le point de départ est la place de la lumière dans nos villes. Ce questionnement prolonge celui de Roma inspiration baroque (2017), en revenant à un regard nocturne, expressionniste. La lumière n'est pas traitée de façon frénétique ici comme dans "Superstructures" (2011), mais interroge sur son volet plus architectural. Comment souligne t'elle l'espace? Comment permet t'elle de lire ces lieux? La lumière est comme le négatif de la structure de jour, elle dessine, souligne, se fait radicale ou vertigineuse, elle révèle. La ville se compose, en intermèdes, une partition visuelle, à laquelle nous sommes tant habitués, sans y prêter une attention, comme si cela allait de soi. Pourtant, il y a cette poésie, récurrente, obsessionnelle. Ces lignes composent des ensembles, modifient notre lecture des lieux, rythment les espaces. Les images sont sombres, contrastées et se jouent d'une réalité qui parfois n'existe pas. Equilibre ou déséquilibre? La lumière n'est pas pensée de façon poétique mais fonctionnelle, elle sert d'autres usages. L'auteur s'y intéresse pour sa substance même, pour sa capacité à structurer, sa potentielle radicalité. Un souffle, une obsession, un vertige.
Das Licht. (2019) Berlin. Retour dans cette ville si inspirante. Pas de couleurs cette fois. Les rythmes sont sombres, contrastés, à la recherche d'une influence expressionniste. Les lumières se découpent dans des espaces, construisent les cadres. Cette série prolonge "Vertigo" la barcelonaise. Ici, la ville est happée par un chaos ordonné. Entre art et histoire, les points de bascule. Les images ont été prises au Reichstag, symbole de tous les possibles. La métropole se vit, sensible et mouvante. Un tourbillon, une écriture de lumière, une folie.
Ces 3 séries (Das Licht, Vertigo et Supernova) sont présentées ensemble lors de l'exposition Métropoles à La Galerie La pierre large à Strasbourg en Mai 2019.
Perspectives poétiques N:21 (pour L'industrie magnifique) place Broglie Strasbourg (mai 2018)
L' intervention pour l'Industrie Magnifique prend la forme d'une installation monumentale d'un mur en béton de 12 mètres de long et de 3 mètres de haut. La sculpture utilise des techniques pointues de photogravure, savoir faire de l'entreprise Béton Fehr, intègre des images faites in situ spécifiquement pour le projet et sera éclairée par des lumières de type néon industriel.
L'objet jouant des perspectives rectilignes de la place Broglie redéssine l'espace, crée des angles, des dynamiques, en modifie la lecture selon le point de vue. Le geste est épuré, presque minimal, malgré la taille imposante, et se veut résolument poétique. Il s'agit de remettre l'industrie au cœur de la ville.
La structure éclairée sera visible de jour comme de nuit évoquant les bâtiments industriels, mêlant des matières brutes au travail
pictural, créant une esthétique particulière propre à l'artiste.
L'oeuvre proposée repose sur une signalétique typique de l'industrie, utilise les compétences particulières du groupe Fehr et inscrit le travail de Benjamin Kiffel dans une synergie collective,
de concert avec l'activité du mécène.
Perspectives poétiques n:21 est aussi un clin d'oeil au fondateur Albert Fehr et son épouse Marthe puisque la numérotation évoquant aussi le process industriel est l'addition de leurs initiales. Graver une mémoire dans le béton et l'inscrire dans le patrimoine culturel et artistique d'un territoire, est à la fois un hommage mais aussi une perspective de rayonnement.
Détail et structure, poésie et sens, épure et matière : l'industrie onirique !
Roma inspiration baroque (2017)
Après une période nocturne et des propositions très urbaines et industrielles (Port du Rhin Strasbourg, Nocturnes, Extérieur nuit), il convient de questionner la place de l'homme dans l'espace et dans la cité d'une autre manière, de poser la question de la lumière différemment.
L'Italie est au cœur de ce mouvement, avec cette proposition romaine tournée sur le baroque.
Qu'est ce qu'une architecture ? Quelle place laisse t-on au sentiment, à l'art , à l'émotion?
On pense bien sûr à la réflexion de Borromini et du Bernin, de Michel-Ange, mais aussi du quartier fasciste. Cette problématique reste prégnante aujourd'hui. Comment concevoir une esthétique? Quel est le rapport au sacré ou au sentiment ? Quelle place accorde t-on aux hommes ?
Rome était donc une étape idéale pour ce questionnement.
J'y suis parti en résidence l'été 2017, une semaine en immersion, focalisé sur cette question, cherchant les fulgurances, la lumière, les structures, l'équilibre, dans cette ville où tout est art, où tout est beau, où tout est si doux.
La démarche n'a rien de documentaire, il ne s'agit pas de restituer, d'illustrer, mais elle emprunte, pour une fois, des ressorts davantage photographiques. Etonnant en effet pour quelqu'un qui se définit comme un plasticien, de voguer vers des registres plus classiques, l'usage du noir et blanc n'est ici pas anodin.
Cette quête de volupté incarne une forme de renaissance, d'attirance vers la lumière. Ces lumières sont naturelles, crues ou davantage satinées, dans des églises, des cours intérieures, des villas, des palais, transcendantes et signifiantes, sacrées ou magiques. Elles dessinent des espaces, façonnent les structures, rythment les perspectives. Il y a peu d'images de nuit, la construction est rigoureuse, la profondeur de champ révèle la ville. Il y a également des angles, des bouts d'architecture, des ciels, des ombres, des découpes qui côtoient des vues de cœurs d'églises, des anges, des plafonds richement décorés. Les compositions sont contrastées, les cadres structurés, les angles variés. Il n'y a personne, pas de vie, la ville semble abandonnée.
Ces vues romaines montrent une harmonie, une douceur, une sérénité. L'inspiration baroque flotte dans l'ensemble comme un leitmotiv, il ne s'agit pas d'ornement, mais d'une identité spécifique, d'un rapport au monde, philosophique, spirituel, et architectural. Une Roma, entre Sorrentino et Fellini, immanente, douce, magique et intemporelle.
Nocturnes (2017)
La nuit, encore et toujours, l'errance, un sentiment d'inachevé, de solitude et de quête de poésie, de douceur, de lumière. Les néons rythment cette échappée, la musique lancinante et enivrante dans la voiture, les cigarettes sont fumées. Il reste un agréable goût de vin espagnol en bouche, il est tard, c'est le cœur de la nuit.
La ville, encore et toujours, qui me donne, ce sentiment, ce souffle, un espace.
Partout du vide, partout, tout est caché, feutré, intérieur, intime, le monde se repose, s'aime, et moi je glisse entre ça...
La poésie, toujours, l'essence des choses, l'ultime conviction, un geste de beauté, pure et absolue, légèrement abstraite, s'il ne reste rien... juste cela, un rêve, un monde à part, une utopie très personnelle, sensorielle, très plastique et des couleurs...
Une écriture, dessiner des espaces, comme pour les réinventer, y mettre son cœur, jouer avec les lumières, les matières, pour composer des structures, donner le cadre.
Le monde proposé évoque l'urgence, le trouble, tantôt flou et subjectif, tantôt froid et radical. Il suggère également une photographie argentique, l'auteur venant de cette période là, travaille toujours de la même manière, en amont, sans post-traitement, et utilise des couleurs comme les pellicules des années 90. Il ne s'agit cependant pas de nostalgie, l'on convoque d'autres ressorts, plus intimes, il ne s'agit pas davantage d'un témoignage d'une ville, dont ces photographies ne sont pas des illustrations.
Les lieux sont anonymes, impersonnels mais recèlent une esthétique particulière, une poésie que le photographe veut donner à voir, un univers dark, sombre, électrique, des espaces qui éveillent des sentiments, des frontières, des émotions.
Port du Rhin Strasbourg (2016)
L'idée de rentrer dans un lieu industriel en activité, pas comme pour l'urbex de façon clandestine, mais pour y voir un lieu encore habité, occupé par son quotidien, sa fonction productive, est ancienne mais n'a été réalisée qu'en décembre 2016. Cet univers est quand même déshabité, ne cherchant pas à en capter un témoignage sociologique ou documentaire, je l'ai donc visité lors d'une pause du personnel dans l'organisation temporelle de l'usine. Ce lieu dégage une magie poétique, avec des formes épurées et des matériaux mis en lumière, et même si cette mise en scène ne sert pas un idéal esthétique, il en résulte un univers un brin daté, comme sorti d'un derrick. Ce travail évoque également les ambiances des pellicules argentiques, fuji ou kodak au tungsten, qui permettaient de jouer avec les lumières, de les faire ressortir, artificielles ; les néons blafards, une image de la ville des années 80, qui a structuré notre représentation urbanistique. Mon intention est de partager cette poésie, ce lyrisme particulier, musical, un peu underground ; puisque ce sont des lieux que nous ne fréquentons pas, sauf si on y travaille, et qui représentent aussi une sorte de fantasme, d'une société qui perd ses usines, ses industries. Il ne s'agit pas de nostalgie, ni d'un discours politique, toujours pas de représentation de la réalité, il faut voir les matières façonnées, peintes, travaillées par la lumière qui dessine ces espaces. Les lieux restent tangibles, presque identifiables, sombres, inquiétants, vides, désespérément. C'est donc aussi un travail sur l'absence, une forme de solitude, contemplative, douce et posée. Le temps s'arrête, l'instant n'est pas décisif, le regard du photographe ne compte pas, il pourrait y avoir en fond sonore du bashung de l'album play et blessures ou de l'électro minimale berlinoise... Derrière un crime a peut être été commis, des trafics illicites pourraient se produire, on peut imaginer beaucoup de choses... L'on se retrouve donc porté dans un univers cinématographique qu'a régulièrement fréquenté son auteur (séries urbaines des années 2000 et encore récemment dans extérieur nuit), qui permet au spectateur de se raconter sa propre histoire, et doit s'approprier et appréhender l'image proposée d'une autre façon qu'un témoignage uniquement réel. Ce travail nous confronte donc à nos propres visions de ces espaces urbains particuliers, à notre rapport à la nuit. Le voyage proposé n'est donc pas seulement une proposition poétique, mais également une invitation au rêve.
Extérieur nuit (2015)
Ce travail est d’abord une promenade
poétique, une quête de lumière, de calme, de couleurs. Attendre le vide, chercher des espaces, trouver une trace, une écriture, une atmosphère, se laisser surprendre par des formes
architecturées, par une ombre, un détail, une fumée d’usine, se laisser porter. L’on se trouve dans des lieux très différents, qu’il ne s’agit pas
d’identifier, l’auteur ne cherche pas à référencer comme dans « utopies » des paysages urbains dont le
traitement de la lumière aurait été conçu de façon réfléchie et spécifique dans une époque donnée. Ici, ils existent, ils sont là, et surtout on y passe, on y glisse, on les regarde un
instant puis on y échappe, ce qui prime c’est le sentiment subjectif d’une errance qu’ils supposent. Dans cette déambulation, l’on peut deviner un paysage inspiré de Hopper, à la mélancolie
suspendue, un ciel de neige en hiver, une usine qui crache sa fumée, des à plats comme peints. La démarche du plasticien, jouant des couleurs, les plaquant tel un peintre, nous immerge dans
une réalité qui lui est propre, faite de néons, de perspectives bouchées, d’angles où quelque chose s’échappe, comme une incertitude. L’on imagine volontiers des tonalités musicales
accompagnant ces pérégrinations nocturnes, rythmant ces vues.
L’auteur renoue un peu avec des images de la fin des années 90-début 2000, avec ce sentiment d’urgence qui émanait de ses séries urbaines, si ce n’est qu’il ne
reprend pas forcément une logique sérielle. On se retrouve donc à nouveau dans un processus d’ordre cinématographique, atmosphérique, témoin d’un temps qui passe, ou se
suspend.
Ce qui est donné à voir, ce n’est pas le spectacle d’une réalité en déshérence, mais la poésie de cette promenade. La nuit en est le théâtre, avec son
calme, ses absences, ses lumières, son pigment. De ces images émane quelque chose d’argentique, un grain, des couleurs comme avec les pellicules, une ambiance un brin datée, décalée. Logique
en somme pour un photographe ne s’intéressant pas à la restitution de la réalité, ni du paradigme de l’instant décisif, et leur préfère une vision davantage
poétique et personnelle, une esthétique particulière, donner à voir du beau là où on ne l’attendrait pas forcément, tenter d’offrir une émotion, un sentiment.
La mer n'existe pas (2014)

Ce travail a débuté en 2013 en Italie avec des images de forêts en contre jour d’un ciel bleu entre chien et loup. Les panoramiques découpent les ombres, aplatissent les arbres qui ne deviennent qu’un vaste espace sombre non identifiable.
La quête s’est poursuivie cette année par une problématique inhérente à deux voyages (en Toscane-Ombrie et à
Lanzarote), c’est à dire comment s’approprier des paysages connus et revus, sans tomber dans le piège de la beauté immédiate de ces lieux ?
La proposition qui tente d’y répondre superpose des images (à la prise de vue sans retouche), et joue avec les
couleurs, le flou, personnalisant ces lieux, les entraînant dans un registre plastique, pictural moins facilement reconnaissable.
Le bleu se fond ici dans la nuit, dans un turquoise subtil et vaporeux, mêlant ciel et mer (pour l’île espagnole),
avec un jeu sur la balance des blancs (réalisé en amont sur l’appareil), dessinant une atmosphère poétique, composant des tableaux presque abstraits. L’on pense à Harry Gruyaert et ses
rivages, l’on pense aussi aux peintures pré impressionnistes, voire romantiques pour le traitement de la lumière. Les images de l’océan côtoient des vues d’Ombrie où les arbres se fondent
dans la nuit, tel un monde sous-marin, magique ; voyage onirique, où les choses ne sont pas exactement ce que l’on croit, les verts se fondent dans le ciel éclairé, éclatant d’un bleu klein
pur... Le procédé de prise de vue est le même : la nuit doit être claire, la lune pleine, la lumière suffisante. Parfois un petit mouvement nous happe, un bateau à l’horizon, puis les
choses redeviennent imperceptibles, diffuses, solennelles, mystérieuses.
La narration de la scénographie nous révèle par ailleurs des images diurnes, rendues abstraites par des
superpositions à la prise de vue, procédé déjà employé par l’auteur (extraits du Saulnois notamment), restituant une forme de poésie n’existant pas de cette façon dans la réalité,
composant des paysages, construisant et jouant avec les imaginaires. Ici encore le travail sur la couleur est primordial, les photographies se diluent dans des bleus très clairs qui s’opposent
aux verts de la terre et des volcans. Les collines sont redéssinées, réinventées.
Il s’agit pour le plasticien de poursuivre sa quête de transformation de la réalité, et le titre au fond doit être
vu comme un manifeste aux accents surréalistes, la réalité n’existe pas, c’est notre regard qui lui confère toute sa poésie et ses significations.
Utopies (2014)
| Ces architectures , qui ne permettent pas de distinguer les villes dont elles sont issues, sont communes, presque anonymes, comme datées d'une autre époque (années 80). La couleur, modifiée ici par les néons créant des ambiances urbaines particulières, soulignant des espaces pas spécialement esthétiques, que l'on voit dans toutes les villes. La nuit amplifiant cette forme de poésie, avec le vide, l'absence, la froideur. Pourtant ces espaces ont fait l'objet d'attention particulière il y a quelques années, on y a travaillé la lumière, pour y construire des espaces urbains de passages, des cours, des placettes... Notre regard sur ce type de lieu change, ce qui est utopie aujourd'hui vieillira également, c'est cela qui m'intéresse dans ces regards, le décalage entre le temps et l'utopie d'avant. L'on peut penser au cinéma de Wong Kar Waï ou de Derrick, à une esthétique quasi cinématographique, mais nous sommes bien en présence d'un travail et de questionnements photographiques. Ces images ont été prises en été 2014, en full frame et ne sont pas retouchées en post traitement. les couleurs ont fait l'objet d'une attention particulière, en amont de la prise de vue avec un réglage de colométrie au point près. Ce travail s'inscrit dans une quête ancienne et récurrente sur l'architecture et ses abstraction possibles, ses appropriations, thème qui a nourrit de nombreuses expositions pour l'auteur. La nuit permettant de sublimer (et d'effacer) certaines lumières, offre de nouvelles perspectives entre les lumières artificielles, les reflets des vitrines... et les espaces ainsi dessinés. L'on joue ainsi avec des concepts de centres commerciaux, de quartiers écologiques d'aujourd'hui, d'industries en reconversion, les confrontant avec des espaces plus anciens qui ont été sujets à réflexion à l'époque. L'obsolescence existe aussi dans les façons de concevoir la vie collective, d'aménager et de structurer les architectures, de penser les lumières, et ce questionnement est visible dans toutes les villes, dans tous les pays. Ces images ont été prises à Berlin, Copenhague, Dubrovnik, Düsseldorf, Hambourg, Kotor, Malmö, Strasbourg. Cette proposition à la frontière d'une démarche plasticienne et documentaire permet de contribuer à un référencement urbain et obsessionnel dans la lignée des époux Becher et de l'école de Düsseldorf par exemple, et de construire une identité architecturée et visuelle spécifique et particulière, européenne, propre à leur auteur qui par ces regards construit un univers qui parfois n'existe pas en l'état (espaces composés) et ainsi nourrit la réflexion de la construction d'utopies et de leur vieillissement... |
Toxic red line (2013-2014)
Ce travail recompose des espaces urbains, sous forme de superpositions à la prise de vue, sans retouche a posteriori donc.
Ces espaces sont détruits, déstructurés, submergés par la couleur rouge qui vient les noyer.
L’on pense à Georges Rousse, notamment dans cette façon de figer ce qui n’est pas, de falsifier, de questionner la perception de la
réalité.
Il y a également une forme d’humour, de décalage, comme dans un mauvais film de science fiction... quelque chose d’artificiel.
L’auteur renoue ici avec un procédé issu de l’argentique (les superpositions), et doit composer des paysages issus de son imaginaire,
détournés du réel, en le faisant directement sur l’appareil, ce qui l’oblige à une construction rigoureuse lors de la prise de vue.
L’on peut également se référer à Tom Drahos pour ses dérives colométriques, là encore travaillées en amont directement sur l’appareil.
Il s’agit également d’interroger la mémoire, le basculement, le moment où cela dérape, change d’état , de nature, d’histoire... thème cher à son
travail, la frénésie, où l’on est emmené, happé par une forme de narration esthétique dans un autre univers.
On peut penser à la série ’’le basculement’’ (2007) ou encore ’’the muppet show’’ (2001) ou dans la série ’’extraits du saulnois’’ (2005).
Ce nouveau travail ne renoue pas pour autant avec une logique sérielle, les images peuvent se lire dans des ordres indifférents, l’exposition mêle
d’ailleurs affichage dynamique et tirage papier.
Le caractère obsessionnel de l’ensemble contribue également à créer une sorte de malaise, sur ce qui avance, se trouble, s’efface, et donc ce qui reste et se recompose, au delà du procédé plastique, de la construction formelle et du jeu des couleurs, se trouve une question essentielle liée à la nature humaine et sa domination, sa capacité de falsification et la dérive idéologique... L’ambition n’est pas de revisiter le chaos, perspective démesurément prétentieuse, mais bien d’en cerner les possibles signes avant coureurs, et le moment où tout bascule...
Urbanités (2012/2013)
Ce travail débuté en 2012, représente un virage dans le parcours plastique de l’auteur. Il s’agit ici de revenir à une écriture plus clinique, nette, moins distanciée du réel, de montrer des espaces structurés, souvent fermés, frontaux ou obliques, construits.
Urbanités se lit comme une typologie de ces lieux, classés, répertoriés comme une unité de mesure de ces sous- espaces, pas toujours totalement identifiables dans leur ensemble, comme un langage universel et poétique.
Le travail prend donc un aspect davantage documentaire, dans le sillage d’un Thomas Ruff ou des époux Becher.
Les villes photographiées ici sont de différentes taille, de différents pays, et ne nous intéressent pas dans leur aspect culturel ou social, mais dans leur approche architecturée. L’installation mêle des images de jour et de nuit, des immeubles et des cours, des arrêts de bus et des parkings, des lieux vides et en attente de reconversion.
La démarche se veut méthodique, reprenant régulièrement un même type de cadrage, les lumières nocturnes devenant des architectures structurant ces lieux, les habillant d’une unité de couleur et de forme visibles.
Après une longue recherche sur l’abstraction, la dimension subjective de ce travail est moindre, le flou est quelque peu délaissé, au profit d’une froideur rigoureusement entretenue. L’homme est absent, mais son empreinte s’inscrit en filigrane. Dans ces mesures urbaines, qui ne reprennent pas de bâtiment dans leur ensemble, la construction s’opère également par opposition, entre différents matériaux, couleurs ou objets. La ville devient par là un regard, un souvenir, une trace, rémanente, de parcelles universelles interchangeables, témoignant aussi de l’activité humaine pour les constructions, abandons ou interventions.
L’on passe de Berlin à Milan, de Turin à Offenbourg, de Strasbourg à Munich, de Zagreb à Prague, de Belgrade à Barcelone, de Bilbao à Madrid...
Ces images ne témoignent pas directement de ces villes, mais de la ville en général, comme d’un artefact, construit, organisé, structuré, offrant un parcours
poétique et l’idée d’une utopie.
Custo (2011)
Ces photographies ont été prises à barcelone en 2011, elles ont été prolongées par des custo germany. Ce sont des panoramiques, dont le mode de l’appareil a été détourné, afin de déstructurer, recomposer, lamélisér les espaces et les lumières. La composition est donc imaginée en amont, et ces images ne font pas l’objet de retouches a posteriori (photoshop)
Le résultat visible est celui construit sur les lieux. L’intérêt ici est de donner un rythme à ces espaces, une dynamique et de créer une émotion picturale par les couleurs structurées et abstraites. La réalité est un support à la poésie ambiante, musicale, onirique et se trouve transcendée par ces formes. Les lieux importent peu et sont finalement peu reconnaissables, tout juste peut on y deviner la tour agbar à barcelone.
Ce travail peut se lire également comme un clin d’œil à la société espagnole post movida, où les couleurs rythment les soirées, les décors sur les habits, dans les assiettes, ou les architectures … (custo est une marque de créateurs barcelonais)
Le modernisme inhérent à cette ville inspire aussi les compositions qui s’intègrent dans un travail plus vaste de destruction de la photographie : dead photography (pas encore montré)
C’est donc une vision festive de la ville, hallucinée, subjective, nocturne qui est proposée.
Cette série succède à des monochromes (simulacre) et poursuit une interprétation du théâtre des réalités urbain, cette vision est peut être plus positive et joyeuse pour l’Espagne, plus froide pour les germany …
Ces panoramiques détournés, permettent (un peu comme les superpositions argentiques) de ne garder que l’essentiel de la réalité, du décor qui n’existe plus en tant que tel mais bien pour les tableaux qu’ils composent, et montrent des paysages n’existant que dans l’imaginaire de leur auteur, les bâtiments sont effacés, la ville aussi, il ne subsiste que des lamelles de lumières, des néons, sur un fond noir profond, cinématographique, des couleurs qui claquent comme dans un rêve…
Dead photography (2010/2011)
Dead photography est un travail débuté en 2010, qui explore les limites du médium photographique. L’usage panoramique de l’appareil est ici détourné, dans des conditions de faible luminosité, afin de déstructurer le réel, le ’’ laméliser’’ , lui ôter toute trace tangible et reconnaissable et lui donner des formes propres.
Ce travail prolonge le travail de démolition de l’image déjà entrepris sur ’’ simulacre’’ ou sur “ textures “ (2004-2009) et témoigne d’une volonté de l’auteur d’utiliser l’abstraction photographique comme un support à l’expression, et de questionner les limites du médium et ses frontières. Les images sont des espaces découpés, en très grand format, non retouchées a posteriori, tout le travail est fait en amont (comme dans une démarche argentique), elles ont été prises d’abord à Berlin, Strasbourg et Barcelone, et poursuivies à Bilbao, Madrid et Budapest. Ces villes sont elles -mêmes des symboles de mutation, et sont résolument urbaines. L’artiste doit
donc imaginer le ’’décor’’ qui n’existe que dans son imaginaire et tenter de le retranscrire en jouant avec les lumières, les formes, et les couleurs lors de cette déstructuration. Ces compositions, devenant ainsi quasi organiques, questionnent donc les limites de la technique photographique, dans le rapport réinterprété au réel, la photographie n’existe pas en temps que telle, ni dans le regard du photographe, mais bien en tant que support plastique à la création. Le bug numérique est donc détourné pour devenir le support de la construction. Le rapport à la ville n’est pas non plus anodin, fait d’espaces coupés, il prend également des accents expressionnistes, dans le rapport à la lumière, composée comme dans des scènes de Fritz Lang, voire constructivistes. Le choix de Barcelone et le Berlin n’est donc pas lié au hasard, ces villes s’inscrivant dans ces questionnements. Les lieux des prises de vues ont été sélectionnés davantage pour leur aptitude à recomposer la lumière que pour leur nature même, intérieurs et extérieurs, parking et structures d’architectures, rues ou couloirs d’hôtel, peu importe finalement puisqu’ils ne sont pas le sujet. Le format choisi, doit faire éclater ces espaces créés, en leur donnant la dimension nécessaire pour en faire un objet en tant que tel. Chaque ville va apporter ses propres lumières et spécificités, ses touches, tout en s'inscrivant dans une démarche globale cohérente. Le résultat intrigue par les traces qu’il dévoile, les reflets de lumière composant les images étant la seule origine reconnaissable. Nous nous trouvons devant un objet abstrait, proche de la peinture, avec des compositions qui éliminent systématiquement la profondeur de champ, registre photographique par excellence, et questionnent également sur la chromie et la lumière qui la révèle, un peu comme dans le travail de P.Soulages . Une recherche assez peu fréquente dans le travail photographique habituel.
La photographie ’’classique’’ est également ’’tuée’’ dans la manière de présenter le travail ; les photographies seront montrées sur plusieurs écrans, les images défilant suivant un rythme et une scénographie travaillés, ce qui permet de dynamiser la narration.
Dead photography est donc également un questionnement sur la matérialisation de notre époque, et sur l’art en particulier, faut
il se retrouver face à l’œuvre en ’’réel’’ pour l’admirer ?
Il ne s’agit pas de supprimer l’œuvre, ni le processus de création, mais de s’ouvrir de nouvelles possibilités de monstration.
Des questions nouvelles se posent ainsi, quel statut pour ces œuvres ? Comment garder la maîtrise du protocole pour l’artiste? Où est la ’’vérité’’ de l’œuvre ?
Va t’on vers des collections de muséographies virtuelles ou dématérialisées ? Peut-on mieux les conserver ?
Ce travail s’inscrit aussi dans une dimension sociétale, et questionne également des problématiques d’époque, obligeant les artistes à se positionner entre nouveaux médias, nouvelles pratiques et éthique de leur création...
Superstructures (2011)
Superstructures est un travail sur l'architecture, sur des espaces oppressants, omniprésents, qui étouffent les perspectives, s'imposent dans leur masse et ne laissent qu'une ouverture noire, sombre, floue, incertaine.
l'on pourrait passer en voiture, glisser sur ces lieux, chercher une issue, ou se laisser dominer, dompter par ces structures, organisées, pensées, dominantes. Le terme superstructures renvoie à Marx et découle des structures, des institutions. Le terme emprunté à son vocable désigne également la construction de rapports de forces et d'illusions dans la perspectives plastiques de nos espaces urbains... Le noir et blanc a fait l'objet d'un travail particulier dans la recherche du papier adéquat, proche du dessin dans ses grisés. Le lieu détourné ici, est en lui même un symbole de masse, et de contrôle par le biais du divertissement, et témoigne de sa puissance, sortes de cathédrales modernes, inspirant les plus grands architectes, lieu de démesure donc, vidé de sa substance, laissé dans sa matière brute, froide, suspecte, expressionniste.
On imagine l'enfermement, qui se prononce dans des dégradés de gris et de noirs de plus en plus sombres, seule luit la lumière, qui claque, froide, structurée, s'imprimant dans notre regard comme autant de motifs cinglants, ne laissant que peu de perspectives, peu de possibilité d'en sortir, comme un envoûtement, un leitmotiv.
La répétition des images, offrant des séquences récurrentes, modifiant juste la focale, et légèrement le point de vue, en fin de série, suppose qu'on ne peut sortir de ce schéma... alors que les premières images suggèreraient plutôt qu'on puisse y échapper, puis le manège reprend... Les tirages laissent apparaître des traces de structures que l'on devine, entre noirs profonds et blancs froids, et renouant avec une tradition cinématographique, l'auteur poursuit ici ce thème de l'enfermement, déjà vu sur " dédales" mais propose une vision plus expressionniste, en noir et blanc, l'enfermement s'il reste mental, apparaît également plus orchestré, organisé, plus paranoïaque... une ambiance sombre, noire, sans issue... et toujours ces néons comme une gravure dans l'espace, l'imaginaire ou la pensée... structurant de façon irréelle notre cheminement, le rendant frénétique, halluciné...
Corps à corps (2011)
Ce travail questionne l'identité, le couple, les tensions, les relations de force, de tendresse, de violence, de possession, de désir...
Le couple peut être perçu de façon multiple, universelle, nous aurions aussi pu avoir 2 hommes ou 2 femmes...
Quelles relations se construisent, comment s'opère la fusion entre les corps, entre les êtres?
L'on parle d'intime, et pour mettre une distance avec ce sujet, la lumière est mise en scène afin d'abstraire le réel des corps, qui sont floutés, colorés, mélangés, jusqu'à ne plus pouvoir les appréhender exactement.
Cette lumière jouant avec les volumes ainsi créés, provoque une atmosphère douce, poétique, presque fantastique, loin des tons chauds et chairs que pourrait supposer un tel sujet. il y a aussi quelques images en noir et blanc. on n'est pas dans une réalité brute et la couleur évoque une ambiance plus urbaine, nocturne, froide...onirique.
Les étreintes priment sur l'identification, les gestes se nouent , les corps se fondent dans le décor... se serrent, s'enlacent, se tendent, se tordent... et composent des formes, des matières, presque des sculptures.
Les images sont prises dans un miroir, prisme figeant ces corps, autre mise à distance du sujet. Les aspérités de l'objet contribuent au caractère plastique de ces photographies.
on se trouve ici dans un questionnement entre D'agata et Coplans...
les personnages se dérobent, se reflètent, se composent... de l'autre côté du miroir,
entre ombre et lumière.
Simulacre (2009/2010)
Simulacre2 poursuit le travail sur la lumière, son entreprise de démolition de l’image , du médium photographique.
Ici la lumière est recomposée, reflétée dans l’espace, par des déflecteurs de vélo, l’on joue sur des plans ainsi crées, matières tantôt granuleuses, tantôt lisses ou nébuleuses, se juxtaposant les uns à côté des autres.
Quand simulacre1 utilisait la lumière en direct, simulacre2 l’utilise, la dirige, la détourne.
La réalité picturale ainsi créée, poétique, ambiguë et toujours tendant vers des monochromes (gris ou orange cette fois-ci) , questionne également sur le médium en lui-même. La photographie n’est elle pas de toute façon un simulacre de réalité ? Un concept n’existant que dans l’imaginaire de son auteur ? La photographie peut-elle être de l’art ?
Le règne de l’image aujourd’hui , son omniprésence , et même son usage pour peindre, questionne sur sa nature, son statut, son essence même.
Les cadrages ici ne permettent pas de reconstituer un réel , ne permettent qu’une approche de celui-ci , éventuelle, évaporée.
La radicalité de la démarche plastique , aux antipodes des paradigmes habituels classiques de la photographie, trouve ses références dans les travaux des plasticiens photographes des années 70, également dans les réponses proposées par Soulages ou Buren…
Comme si l’auteur dans son parcours artistique n’avait de cesse de « tuer la photographie » ( ambition proclamée d’ailleurs dans son nouveau travail : dead photographie- visible en 2011 )
Il reste quand même des traces , des débuts de pixels, et des palettes de couleurs complexes voulant apparaître, sorte de bug numérique questionnant également sur les limites (ici détournées comme procédé) du médium.
Que ce soit en argentique ou en numérique, l’artiste travaille sur ce qu’il ne faut pas faire en photographie (temps de poses, bougés, flous, exposition en faible luminosité…) et expérimente les limites du médium, l’utilisant justement exclusivement dans ses faiblesses, pour construire son propre imaginaire.
Extraits du saulnois (2005)
Extraits du saulnois est un travail qui date de 2005, qui a été montré au musée
du sel (marsal en 2008)
qui a gardé une partie de ces photographies.
Le saulnois est un pays situé en Lorraine, pas un espace industriel ou minier comme on a l’habitude de se l’imaginer mais rural, entre Metz, et Sarrebourg.
Lors d’interventions scolaires je fus frappé par la lumière ambiante très changeante selon les saisons et la poésie de ces paysages.
Ce travail onirique , en argentique, construit par superposition, est une
appropriation personnelle d'un espace rural, de jour, aux antipodes des lieux
qui habituellement m’intéressent. J'ai voulu construire à partir de
fragments un saulnois imaginaire. ces paysages ainsi crées mélangent des
clochers d'église et des vaches, des vignes et le ciel, de l'eau et des
routes... plus cette histoire se raconte, plus on va vers des motifs
géométriques, aux cadrages serrés, pour finir par une croix qui montre que ce
paysage n'appartient qu'à l'imaginaire de son auteur... cette croix avait été
construite sur la façade du musée le temps de l'expo sous forme d’installation
rappelant le passage du photographe voulant rendre quelque chose à ces paysages
empruntés, et comme un questionnement également sur le paysage en lui même: une lumière n'est elle pas déjà le début d'un paysage?
Abstractions (2001-2011)
Cette envie de chercher les limites du médium est récurrente, il s'agit de tester, d'expérimenter, de voir où est le degré minimum d'une photographie, à partir de quel point, de quelle couleur, de quelle trace peut on dire que nous sommes en présence d'une photographie?
Les références sont ici bien sûr dans les artistes conceptuels des années 60, jusqu'à Toroni ou Soulages.
Ce questionnement restant relativement rare en photographie, où il est essentiellement question de regard photographique, d'instant décisif, d'un rapport magique avec la réalité, et ne s'inscrit pas dans sa tradition ni dans l'imaginaire habituel du photographe.
Cette réalité ici n'est utile que pour son appropriation, ses lumières, sa construction méthodique, obsessionnelle, nulle intention de raconter des évènements qui se seraient produits, de reconnaître des lieux tangibles. La photographie sert à capturer la lumière et à construire des formes, des lignes.
A partir de quelle texture, de quelle trace de lumière est-on en présence d'une photographie (textures 2003 avec téléphone portable) ?
La lumière, quête par essence de la photographie, peut également se révéler par des a-plats de couleurs (sans profondeur de champ comme sur custo ou dead photography)
Le travail d'abstraction, de démolition du réel a fait l'objet de nombreuses expositions pour l'auteur avec une construction technique particulière, faire ce qu'il ne faut pas faire, et utiliser les limites même de la photographie pour s'ouvrir un espace créatif...(flous ,bougés, superpositions) et en faire sa signature.
L'on peut jouer avec des lumières pour créer des personnages imaginaires, composer ce qui n'existe pas, inventer avec les contraintes liées au médium.
Ce thème répond donc à une quête également poétique, rapport suspendu au temps, où l'image n'existe pas pour ce qu'elle représente mais dans l'imaginaire de celui qui la regarde, ce qui a également comme fonction d'abolir la frontière entre le créateur et le spectateur, qui, obligé de se questionner, s'approprie ces tableaux.
Enfin, la photographie ne cherche pas le beau, mais le discours, préfère le questionnement à la révélation,
et s'inscrit dans une démarche plasticienne assumée, construisant un univers visuel propre, essayant de relier ces problématiques à des questions sur l'évolution de l'histoire de l'art, jouant avec des références qui ont nourri le parcours intellectuel de leur auteur...
Détournements (1998-2004)
Série datant des fin des années 1990 et début des années 2000, en argentique, qui détourne les codes culturels de l'époque, les publicités imposées aux regards, les séries tv mythiques, les espaces urbains évoquant des atmosphères particulières. L'idée est de mettre de la poésie là où il n'y ne a pas forcément, et de donner à voir une réalité imaginaire...
De nombreuses séries viennent dialoguer avec cette thématique. Des mises en scène dans l'espace public, des travaux drôles et décalés (L'inspecteur Derrick par exemple), des affiches publicitaires qui deviennent des personnages oniriques (Opium), des peluches de grands magasins des personnages à part entière (Le Muppet show), un rapport à distendre le réel, et expérimenter ce qui dans le médium photographique permet une appropriation particulière de la réalité. Je ne m'intéresse pas à l'instant décisif, je ne m'inscris pas dans une lignée d'une pure technique photographique, ma revendication est plasticienne avant tout. J'utilise donc des flous, des bougés, des jeux sur les temps de pose, des superpositions pour magnifier, transformer le réel. Je ne post-traite pas mes images, issu d'une culture argentique, j'aime construire mes travaux en amont au cours d'un processus de réflexion approfondi. Le détournement est une démarche récurrente, l'on peut utiliser des architectures et les faire discuter avec autre chose, les sortir de leur usage, de leur fonction, et interpeller, favoriser un questionnement, émouvoir. Jouer de nos imaginaires et interroger nos registres culturels contemporains.